Photo : Paks II Ltd
La construction de la centrale nucléaire Paks II en Hongrie, pilotée par Rosatom, illustre les défis et paradoxes des relations énergétiques entre l’Union européenne et la Russie. Ce projet, approuvé depuis 2014, a franchi une étape clé en 2024 avec le début des travaux. Cette initiative soulève des questions économiques, géopolitiques et environnementales, dans un contexte marqué par les tensions entre Moscou et l’Occident.
Un projet stratégique en Hongrie
Paks II, situé à environ 100 km de Budapest, s'ajoute à l’actuelle centrale nucléaire de Paks, qui fournit déjà une part importante de l’électricité hongroise. Rosatom, entreprise publique russe, est le maître d’œuvre de ce projet colossal, financé en grande partie par un prêt de 10 milliards d’euros accordé par Moscou (pour un coût total de 12 milliards d’euros). Une fois opérationnelle, cette centrale augmentera significativement la capacité énergétique nucléaire du pays, garantissant son indépendance énergétique et réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.
Malgré les sanctions européennes contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine, ce projet bénéficie d’une exemption. Cette décision repose sur des considérations pratiques : l’énergie nucléaire est essentielle pour la Hongrie, qui ne peut se permettre de rompre ce partenariat sans alternative immédiate.
Les motivations de Budapest
La Hongrie, dirigée par Viktor Orban, a défendu ce projet comme étant crucial pour son développement économique et sa sécurité énergétique. La construction de Paks II s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à diversifier les sources d’énergie tout en respectant les objectifs climatiques européens. Orban, souvent en désaccord avec Bruxelles, a négocié des compromis pour préserver cet accord avec la Russie.
Cependant, cette initiative alimente les critiques de certains membres de l’UE, qui y voient une tentative de contourner les efforts pour isoler économiquement Moscou. La dépendance croissante de la Hongrie vis-à-vis de la Russie est perçue comme un risque stratégique dans un contexte géopolitique tendu.
Le rôle de la France et d’autres acteurs européens
Fait notable, la France, par le biais de son entreprise Framatome, pourrait participer au projet. Cette collaboration illustre l’ambiguïté des positions européennes sur le nucléaire russe : tout en sanctionnant Rosatom dans certains domaines, plusieurs pays de l’UE restent liés à l’expertise nucléaire russe. La participation française témoigne également d’une volonté de maintenir une influence dans ce secteur stratégique et de ne pas laisser Rosatom en situation de monopole.
Les enjeux pour Rosatom
Pour la Russie, Paks II représente une vitrine stratégique en Europe. Ce projet consolide la position de Rosatom comme leader mondial du nucléaire civil, tout en offrant une opportunité d’affirmer sa présence dans l’UE malgré les sanctions. La participation de Rosatom à des projets similaires dans d’autres régions d’Europe centrale témoigne d’une stratégie d’expansion à long terme.
Controverses et perspectives
Les critiques de Paks II soulignent les risques d’une dépendance accrue envers la technologie russe, notamment en cas d’aggravation des tensions politiques. Certains experts mettent également en avant les défis techniques et financiers de la construction, qui pourraient souffrir de retards et de dépassements de coûts.
D’un autre côté, les défenseurs du projet insistent sur ses avantages : une énergie fiable, respectueuse de l’environnement et indispensable pour atteindre les objectifs climatiques européens. Ils soulignent également que couper les ponts avec Rosatom pourrait ralentir la transition énergétique de la Hongrie.
Le projet Paks II symbolise les dilemmes auxquels l’Europe est confrontée : concilier indépendance énergétique, transition écologique et pressions géopolitiques. Alors que la Hongrie poursuit ses ambitions nucléaires avec le soutien de la Russie, ce projet rappelle que l’énergie reste un terrain de coopération et de confrontation entre l’Est et l’Ouest. Les prochaines étapes de Paks II seront suivies de près, tant pour leurs implications techniques qu’en termes de politique internationale.

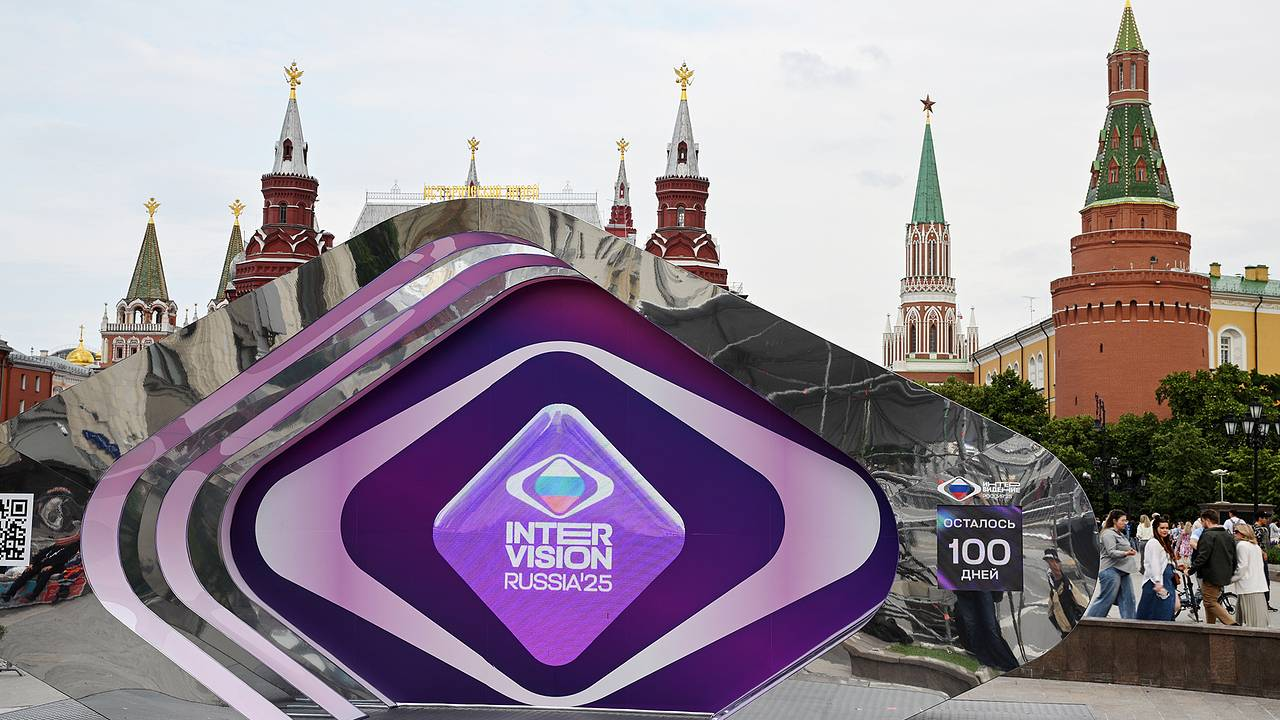



Les commentaires
Pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter cet article !